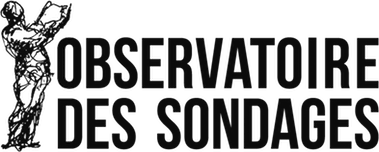On n’a que l’embarras du choix pour voir concrètement ce que la presse fait des sondages à moins que ce ne soit ce que les sondages font à la presse.
Titre de l’article : La taxe carbone fait chuter la popularité du président de la République (Le Monde, 23 septembre 2009)
Comment le journaliste le sait-il ? Démonstration en trois temps.
![]() Selon un sondage réalisé par l’Ifop pour le Journal du dimanche, le Président perd 6 points en un mois. Explication du sondeur : « cette chute est clairement liée à la taxe carbone ». Preuve ? « les sondés nous disent…. ». Cela devrait signifier que le sondage a été accompagné d’un « quali » où d’autres personnes ont participé à un entretien car le sondage cité ne peut donner ce genre de renseignement. On n’en saura pas plus.
Selon un sondage réalisé par l’Ifop pour le Journal du dimanche, le Président perd 6 points en un mois. Explication du sondeur : « cette chute est clairement liée à la taxe carbone ». Preuve ? « les sondés nous disent…. ». Cela devrait signifier que le sondage a été accompagné d’un « quali » où d’autres personnes ont participé à un entretien car le sondage cité ne peut donner ce genre de renseignement. On n’en saura pas plus.
![]() Deuxième temps : le journaliste vérifie par une contre-expertise… auprès d’un sondeur. Le politologue de CSA doute. Pour lui, les cotes de popularité baissent quand le Président se tait. Pas gentil mais conforme à ce qu’on sait des baromètres de popularité : plus la personnalité apparaît dans les médias, plus elle monte et inversement. Bref, ces baromètres enregistrent l’écho d’un bruit médiatique. Pas de quoi en tirer grand-chose. Dans une activité qui ne produit guère de vraies connaissances, c’est une des moins solides.
Deuxième temps : le journaliste vérifie par une contre-expertise… auprès d’un sondeur. Le politologue de CSA doute. Pour lui, les cotes de popularité baissent quand le Président se tait. Pas gentil mais conforme à ce qu’on sait des baromètres de popularité : plus la personnalité apparaît dans les médias, plus elle monte et inversement. Bref, ces baromètres enregistrent l’écho d’un bruit médiatique. Pas de quoi en tirer grand-chose. Dans une activité qui ne produit guère de vraies connaissances, c’est une des moins solides.
![]() Troisième temps : on apprend que « l’Elysée et l’UMP […] ont commandé leurs propres sondages…. ». C’est une information. L’instrument est-il de mauvaise qualité, on en commande plus. C’est la stratégie du sapeur Camembert ou du soldat Schweik appliquée aux sondages : plus les sondages sont insignifiants, plus il faut en faire. Ou encore, on parvient à l’exactitude en additionnant les erreurs. Qui est « on » ? L’Elysée, l’UMP, Publifact, et enfin le contribuable français qui finance cette campagne électorale permanente.
Troisième temps : on apprend que « l’Elysée et l’UMP […] ont commandé leurs propres sondages…. ». C’est une information. L’instrument est-il de mauvaise qualité, on en commande plus. C’est la stratégie du sapeur Camembert ou du soldat Schweik appliquée aux sondages : plus les sondages sont insignifiants, plus il faut en faire. Ou encore, on parvient à l’exactitude en additionnant les erreurs. Qui est « on » ? L’Elysée, l’UMP, Publifact, et enfin le contribuable français qui finance cette campagne électorale permanente.
A la fin, qui mettrait en doute le titre ? Comme le disent les journalistes pour justifier leur usage des sondages : « c’est une information comme une autre".